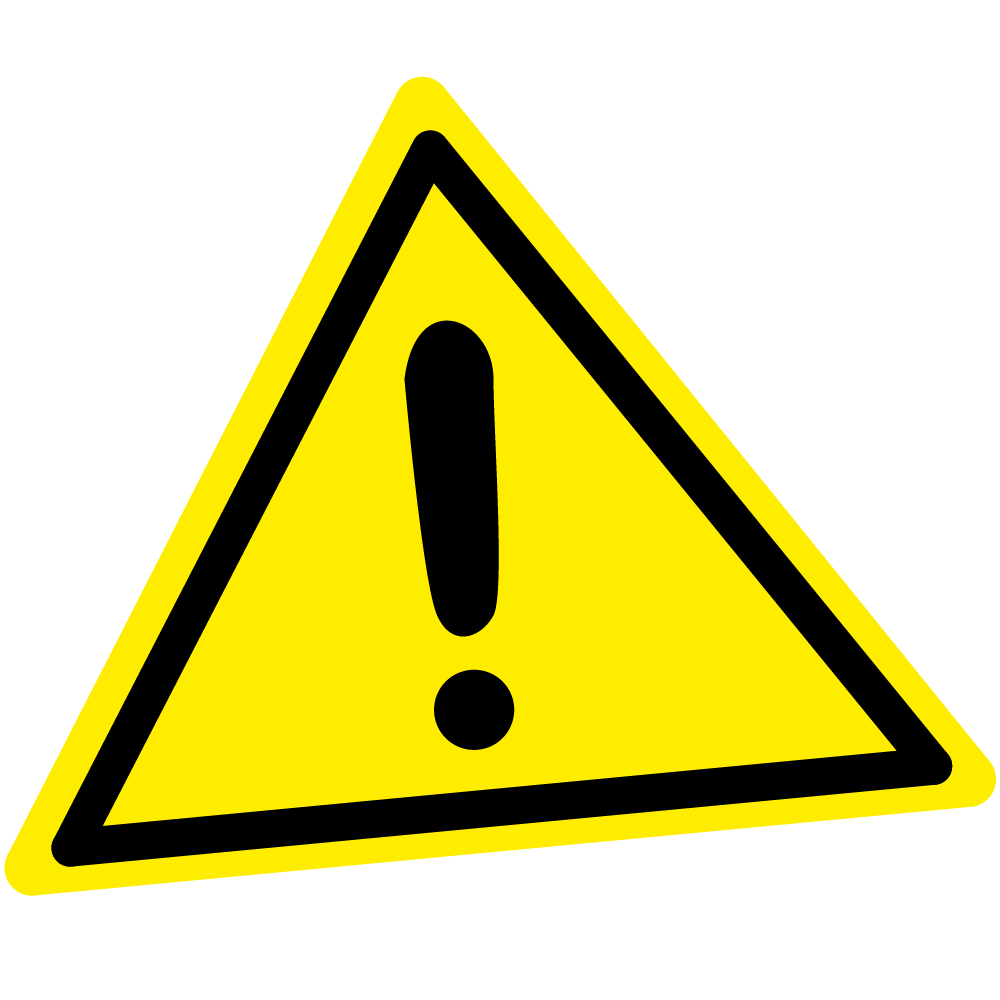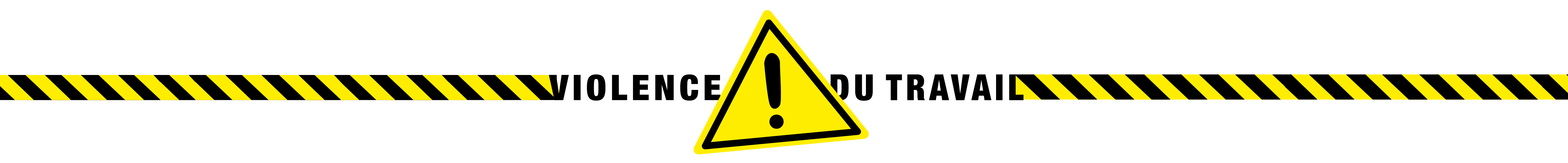Comme beaucoup d’étudiantEs, cet été là, je dois trouver un petit boulot me permettant de compléter mes revenus pendant l’année scolaire. Une amie me parle alors d’une association recherchant des « femmes de ménage » pour les remplacements estivaux. Bercée par l’idéal qu’il n’y a pas de sous-métiers et la facilité de l’offre d’emploi, j’y vais.
Le flou des consignes de travail
Alors que j’arrive à l’association le jour de mon entretien d’embauche, je me demande sur quels critères ma candidature sera jugée. En réalité, l’entretien se révèlera très court. On ne me demande rien ni sur mes compétences, ni sur mes motivations, ni même sur mes précédentes expériences professionnelles (nulles à cette époque). Il s’agit plutôt de m’exposer ce que fait l’association : elle propose des services à domicile, principalement pour des personnes âgées ou très dépendantes (handicapées). J’apprendrais par la suite que l’association est parfois mandatée par des services sociaux. Certains d’entre eux souffrent, en outre, de problèmes mentaux qui peuvent rendre la relation aux aides ménagères très compliquée. Chez Madame Bacha par exemple il ne faut rien toucher ou jeter. Son appartement est l’antithèse d’un lieu de travail sain : poussière, déchets et moisissure occupent tout l’espace, au point qu’ouvrir la porte pour entrer dans l’appartement est en soi une victoire.
La nature du métier de l’aide à domicile est mystérieuse pour moi. Je demande donc ce que j’aurais à faire. Apparemment je n’ai pas à m’en inquiéter, il s’agit d’aider les personnes dépendantes dans les tâches quotidiennes : servir les repas, nettoyer le linge, et bien sûr faire le ménage. En théorie, l’association dispose pour chaque bénéficiaire d’une fiche censée détailler les tâches attendues. En pratique, je n’utiliserai que peu ces fiches, soit parce que je ne les ai pas eu en mains, soit parce qu’elles n’étaient pas à jour. Ainsi en est-il pour Madame Yolanda. Sa fiche indique qu’il faut lui amener une baguette de pain, alors qu’elle n’est plus en mesure d’en manger depuis plusieurs mois. En l’absence de fiche, je suis censée faire le ménage et plus généralement aider les bénéficiaires, qui me diront eux-mêmes les tâches que je dois réaliser. On me précise cependant qu’en aucun cas je ne suis autorisée à faire quoi que ce soit sur leurs corps, car en cas d’accident je pourrais en être tenue pour responsable.
Le travail n’a pas l’air compliqué. Je signe mon contrat et commence le lundi suivant.
« Je me souviens de ce que la recruteuse m’avait dit : le corps est la limite. Oui, mais les cheveux, est-ce déjà le corps ? »
Premier jour de travail, je me présente à 9 heures, ponctuelle, chez une bénéficiaire de l’association qui m’a fraîchement recrutée en tant qu’aide à domicile – et non comme femme de ménage comme je le pensais. Je sonne. Une femme entre deux âges m’ouvre la porte, visiblement confuse de ma présence. Elle ne sait pas qui je suis. Je lui explique que je suis une nouvelle employée, envoyée par l’agence d’aide à domicile et que je viens chez elle pour faire le ménage. Il faudra plusieurs minutes et coups de téléphones à ladite agence pour qu’elle me croie et qu’elle me fasse entrer. Je comprends que la première étape sera de me faire accepter.
Après cette présentation – chaotique – je fais un rapide état des lieux de l’appartement : rien ne sort de l’ordinaire, de la vaisselle dans l’évier, un peu de poussière… Mais très vite elle me dit qu’aujourd’hui elle veut que je l’accompagne au centre commercial pour changer le nouveau téléphone qu’elle vient d’acheter et qui ne marche pas. Personne ne m’avait mentionné que je devrais faire ce genre de choses. Ou plutôt, il me semble bien qu’on m’avait dit que je devrais faire le ménage, et les aider sur des activités du quotidien. Je fais un rapide calcul : je suis mandatée pour deux heures, le centre commercial est à 40 minutes de bus (et je n’ai pas de ticket), 30 minutes viennent de s’écouler et je dois être à 11h30 chez une autre bénéficiaire qui se trouve à 20 minutes de vélo. Aller changer le téléphone ne sera pas possible.
Je lui explique que l’on n’aura pas le temps et que je ne suis pas certaine que cela fasse partie de mes attributions, mais elle n’en démord pas. A nouveau coup de fil à l’agence. Oui les excursions en centre commercial font partie de mes missions si cela est considéré comme l’aide dont le bénéficiaire a besoin. Très bien. L’infaisabilité temporelle de la chose ne semble pas être un argument recevable.
Je lui propose un arrangement : pour cette fois c’est trop tard, mais si elle le souhaite nous irons la prochaine fois. Il me reste une heure, pourquoi ne pas faire un peu de ménage ? L’accord est conclu : je fais la vaisselle, je passe l’aspirateur, récure les toilettes. Au moment d’attaquer la salle de bain elle entre, se met nue et m’annonce qu’elle va se laver les cheveux. Je bats en retraite et c’est alors qu’elle m’interpelle : je n’ai pas compris, elle veut que je lui lave les cheveux.
Je suis décontenancée, et très mal à l’aise face à sa nudité. Et je me souviens de ce que la recruteuse m’avait dit : le corps est la limite. Oui, mais les cheveux, est-ce déjà le corps ?
Les premiers jours de travail ont été très difficiles pour une paye minime. Ce que j’ai vécu comme la plus grande difficulté est la solitude : se retrouver confrontée à des personnes, souffrant de troubles cognitifs parfois important, sans consignes, ou avec des consignes en décalage avec la situation réelle, le tout sans expérience et sans formation pour m’aider à m’ajuster. La nécessité d’apprendre « sur le tas », qui pose question lorsqu’il s’agit de relations humaines.
J’avais besoin d’argent. Et je me confortais dans l’aspect temporaire de cet emploi. Au début je ressentais une grande culpabilité lorsque je refusais de faire quelque chose, ou lorsque je n’arrivais pas à laisser l’appartement plus propre à mon départ qu’à mon arrivée. Et puis rapidement la culpabilité est partie. Je n’avais nulle connaissance du règlement de l’association, je décidais vis-à-vis de ma conscience de ce que je voulais bien faire ou non.
La question du faire ou ne pas faire ne s’est jamais posée pour des tâches domestiques, récurer des toilettes ou un four, laver les sols ou les petites culottes, je m’en fichais bien. Ce qui était problématique, pour moi, est tout ce qui touchait à l’être humain. Il n’était pas question que je lave des cheveux, tâche que je jugeais de l’ordre de l’intime. Mais il m’est arrivé de nettoyer les fesses d’une personne qui s’était souillée, tâche touchant au corps et donc interdite mais qui, pour moi, relevait de la décence : il n’était pas question de laisser une personne dans sa merde jusqu’à l’arrivée de l’infirmière, plusieurs heures plus tard.
Texte initialement paru sur Terrains de Luttes
Mots clés : ViolenceDuTravail, aide à domicile